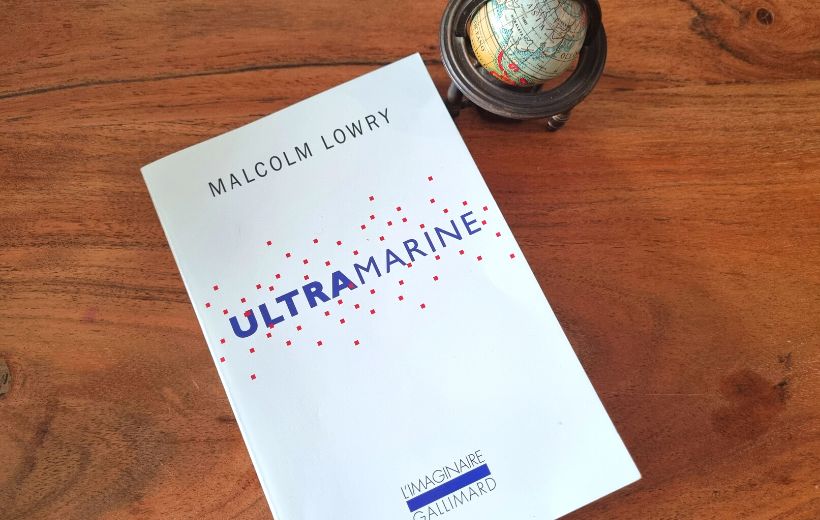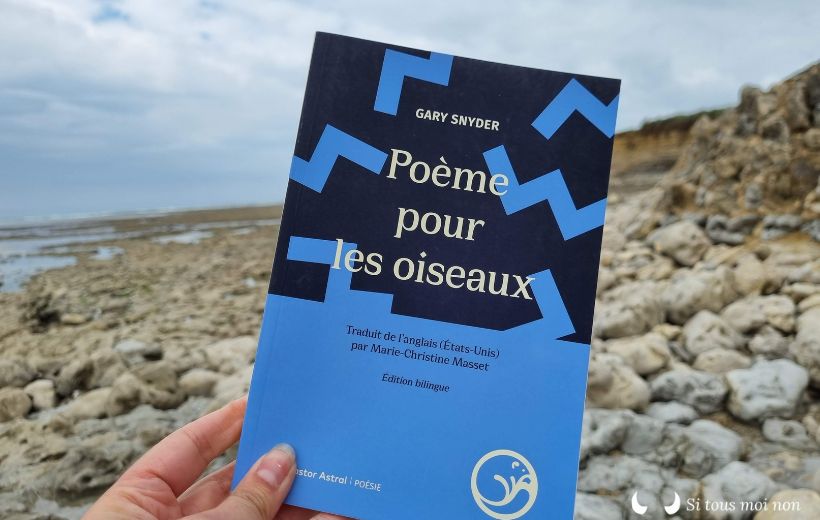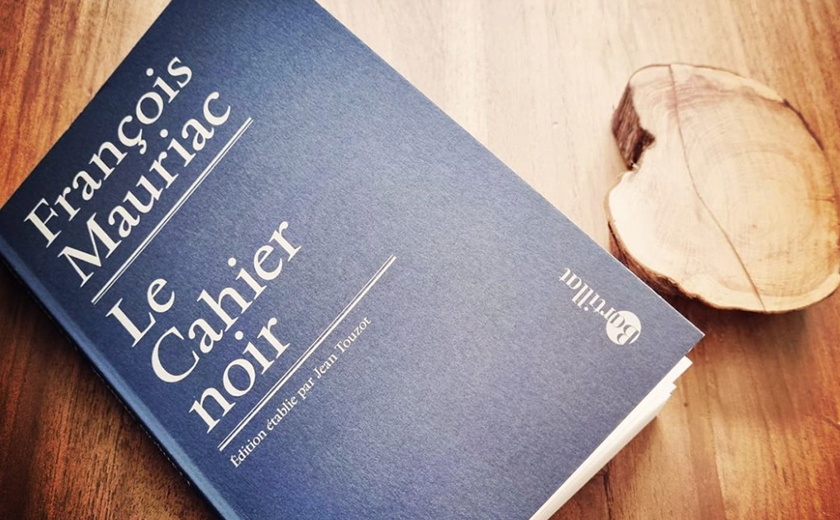« – La guerre, c’est schrecklich, schrecklich. Il faut se battre pour savoir.
– La guerre est schrecklich, oui.
– Peut-être tu écriras un livre sur tes expériences.
– Ja, peut-être, dis-je. C’est une idée. Mais le désir d’écrire est une maladie comme n’importe quelle autre maladie, et ce que l’on écrit, si l’on veut être un tant soit peu efficace, doit être solidement ancré dans une sorte d’autochtonie. Et là j’abdique. Je ne suis pas plus capable de créer que de voler dans les airs. Ce que je pourrais achever serait le sempiternel, timide premier roman dont il serait rendu compte à la morgue du Times Literary Supplement, « une œuvre indigeste et mal agencée », quelque chose de cette nature, dont le personnage ne serait ni plus ni moins pris d’alcool ou d’amour que l’abominable auteur en personne. Et puis, je crains que ça ne soit qu’une maladie infantile, diarrhea scribendi, rien de plus. Mais excusez-moi, je n’exige pas que vous me suiviez, je m’exprime toujours ainsi quand je suis noir. » (page 107)*
Tout jeune homme, Malcolm Lowry embarqua pour la haute mer, officiant sur un vapeur, comme Joseph Conrad, Herman Melville et Nordahl Grieg, ses influences littéraires principales avec Conrad Aiken. [Pour ce dernier, je ne trouve nulle part confirmation qu’il fut aussi, un temps au moins, marin, bien qu’ayant écrit un roman de mer, Au-dessus des abysses, que Lowry sait avoir largement plagié pour Ultramarine, titre dont l’expression est d’ailleurs d’Aiken.] En plus d’une poignée de poèmes salés, il tira de son expérience un manuscrit sans cesse retravaillé, son premier roman.
Si le meilleur philosophe n’a jamais qu’une seule idée qu’il répétera dans chaque livre, comme le prétendait avec provocation et malice Clément Rosset, l’on pourra pressentir avec Ultramarine que le grand écrivain ne se découvre qu’une seule cavité des abysses à explorer, une obsession telle que la décrivait Ernesto Sabato dans L’Ecrivain et la catastrophe qui, lorsqu’elle le harcèle et seulement au point qu’il en devienne presque fou, le contraigne à prendre la plume pour sinon l’épuiser, au minimum la contraindre à cracher ses jets les plus purs, jusque dans son dernier cratère bouillant. Il vise alors le Z du A à Z qui tourmente tant M. Ramsay, le philosophe un peu raté de Vers le phare de Virginia Woolf, qui aimerait au moins toucher le R au terme de sa vie.
Le grand écrivain ne se détournera jamais de ce qu’il entreprend de défricher, au péril de son équilibre mental. Libre dans sa cellule, comme le hurlait cette fois-ci Maurice G. Dantec dans American Black Box.
Sans l’avoir vérifiée encore puisqu’Ultramarine est le premier roman de Lowry que je lis, je pars donc sur cette intuition dévoilée dès la préface par sa veuve : ce livre est un « voyage qui ne finit jamais », titre de travail général que Lowry envisageait de donner à son livre comme à ceux qui suivraient. Je n’ai pas encore lu le monumental Sous le volcan, ni Lunar Caustic, ni Sombre comme la tombe…, ni Voyage vers la mer blanche ni… voyez, je place virginalement mes pas sur la nouvelle trace d’un sentier de roches apparemment identiques mais de plus en plus escarpées et brûlantes, que je tenterai d’escalader dans l’ordre de leur conception, tombant dans le volcan – chronique d’un accident annoncé – pour m’en relever, peut-être, assommée par les vapeurs promises… qu’en sais-je encore ? je ne pars jamais pour mourir, mais ne renonce pas aux risques encourus : une chose est certaine, ce voyage ne fait que commencer.
Pourquoi partir en mer ? Dans Moby Dick, Ismahel se fait railler par le capitaine auprès de qui il s’annonce pour embarquer, désirant « voir le vaste monde ». Ah, tu veux voir le monde, lui rétorque le loup de mer. Va donc sur le pont, tourné vers le large, et dis-moi ce que tu vois ! Le voici, ton monde – est en substance la première leçon que prend le bleu. Mais qu’importe, tant pis pour le monde, il veut y aller surtout pour affronter la baleine.
Dana Hilliot, fils à papa (qu’il lui faudra tuer pour se faire accepter de l’équipage, comme Lowry doit tuer, lui, ses modèles littéraires en les pillant), malaimé par sa mère dont il se heurte d’une seule lettre indélicate (le bateau se nomme par ailleurs Oedipus Tyrannus, ajout tardif au manuscrit) et amoureux transi de Janet, omniprésente ou plutôt omniabsente comme le Dieu autour duquel il tourne, fidèle de la plus chevaleresque espèce quoiqu’un peu vexé de s’être laissé ainsi prendre par une belle abstinente, lui, cherche un monde spécifique où se révéler et non pas « le vaste monde », une escale aux promesses si luxuriantes et magnanimes qu’il consentira enfin à descendre du bateau, où il pourra cesser de penser et se mettre en mouvement. Il rêve ce vrai lieu où, intact en lui-même, ses actes seront en conformité, environné de beauté, loin de l’horreur, de la vulgarité et de la mesquinerie de la vie promise aux moins ambitieux…
…et consent pour tenter d’y parvenir à une traversée dans son exact contraire : un cercueil tyrannique qui tangue dans un bruit infernal, bruits formant la « voix » du bateau qui intervient à force de tinn-tinn, de clong clung ou de craquements lugubres au milieu de toutes les langues mêlées des matelots, une Babel maritime embrumée par les rêveries en grec ancien ou en norvégien du pâle héros éreinté et acculé à faire naître une pensée de plus en plus ramassée pour l’écraser en gerbes essentielles, concentrées, saturée de l’écume d’une énergie aussi sexuelle qu’intellectuelle.
Dans ce huis-clos, les petites aventures se content en de larges tournants, les anecdotes mythomanes se confondent au vécu, alors qu’Hilliot, pris en grippe par une grande partie de l’équipage, le grand et fier Andy en tête, au menton perdu pendant la guerre, tente moins de s’en faire accepter que de supporter cette mise à l’écart du rang des mâles solides. Plus que les autres, Andy l’humilie et le recouvre d’ombre. Sa confrontation avec ce pilier invaincu au menton d’Achille lui permettra-t-elle de définir plus concrètement sa place sur le bateau, et parmi les hommes ? « J’ai assumé Andy », finira-t-il par écrire, imaginairement, à sa fiancée, dans le plus puissant et lyrique morceau de bravoure du livre. « Il me faut accepter Andy, poursuit-il plus loin, ce n’est pas plus dangereux que d’accepter la vie. Mais, à l’avenir, plutôt que n’en plus finir de naître, de moi je dois me rendre maître, – au lieu de lever le coude, je lèverai des poids et haltères. Quant à mes livres, je les jetterai par-dessus bord, et j’en achèterai d’autres. […] Je veux être un homme ! Aller, de nouveau, à la mer ! » (p 212)
Mais pour l’heure, rien à faire, sur son promontoire au-dessus des bêtes des cales et des flots déchaînés il se tient inaccessible, boit comme un trou, pour toujours séparé, isolé des autres bêtes par l’acuité d’un esprit qu’il exerce avec salut autant qu’il tente de l’abrutir. Il lui faut mériter sa place, mais comment ? Le souhaite-il vraiment ?
De bêtes, littéralement, par ailleurs, il y en aura beaucoup : la menace du requin dans chaque rade, où les eaux peuvent parfois regorger de fausses couches déversées par la maternité sise sur les berges, d’étranges rêves alors qu’ils ont embarqué un zoo à déplacer, dans lesquels les fauves dévoreront une partie de l’équipage lors d’une queue de typhon qui les libère, un pigeon voyageur au message énigmatique qui finira noyé…
Dans l’étreinte de ce bateau qui semble transporter une jungle primitive, qui parle, bruisse, se blesse et saigne de ses animaux les plus dangereux, un être ultrasensible, menacé par ses semblables si différents de lui, tente de rejoindre l’île idéale, forcément loin, le plus loin possible de lui-même. Erreur de jeunesse et de perspective ? Fallait-il chercher le large pour se rencontrer – le large pour lutter contre l’étouffement du navire-soi, semer ses spores et embrasser le reste, oui, mais pour se rencontrer, il convient de descendre, ce que Lowry, apparemment, sait déjà très bien, ayant une longueur d’avance sur son personnage qu’il laisse pour ainsi dire en plan dans son rêve.
« La géographie d’Eschyle n’était probablement guère plus chaotique que la mienne. […] Je n’avais pas encore lu sa lettre. Je la sentais dans ma poche, chaude contre mon cœur. Hilliot invictus. Prometheus absolutus, Dana solutus. La solution sur ma poitrine. Pas d’erreur de géographie dans le λυόμενος , Desmotes. Les cavernes sans langue des anfractueuses collines crièrent alors misère, les cieux vides répondirent misère, les vagues violettes de l’océan à l’assaut du rivage mugissaient dans les vents cinglants, et les peuples blêmes entendirent misère ! » (p 118)
Mais le persona Dana nourrit une autre obsession que son île, à moins que ce ne soit exactement la même : celle de se frotter à la littérature au fond même des cales du bateau, comme Prométhée s’est frotté au feu. Aider les enfants dénutris, soigner la misère, se rencontrer dans une oasis reconstituée et préservée du reste du monde, rester pur, tourmenté par les tentations triviales. C’est peut-être paradoxalement par l’immobilisme relatif de la littérature qu’il en sera seulement capable**. Sa référence constante aux antiques parmi les plus antiques – les grands, profonds et parfois aveugles Grecs, abysses de notre littérature – le place en éclaireur des plus ancestrales cavernes (Sophocle pour le bateau, Homère pour la mer violette, mais surtout Eschyle, dont la trilogie Prométhée enchaîné (desmốtês), délivré et porte-feu nous est parvenue uniquement fragmentaire, et qui passe pour le plus ancien dramaturge dont les textes nous soient parvenus).
La fréquentation des Antiques, mais surtout l’expérience de la guerre et de la mer ont produit les meilleurs écrivains, Lowry s’est jeté à l’eau, Hilliot l’envie, mais le tance et le défie. Il n’y arrivera pas. Trois, quatre éclairs déchirant la fiction viennent donner subrepticement un aperçu de ce que vise Lowry, trois, quatre passages (dont celui en ouverture de cette chronique) sur l’écriture et la critique qui pourraient n’être que narcissiques digressions mais ouvrent une dimension de plus dans cette étendue mouvante et insaisissable qu’est Ultramarine. Et la rend définitivement passionnante.
« La tragédie de l’après-midi, les affres du voyage, tout était oublié. Subitement il eut de lui-même une vision d’une parfaite netteté : une feuille rouge tombée sur un torrent blanc. D’un seul coup, dans sa vie, il n’y eut plus ni incohérences, ni ruptures de temps, ni flottements, ni grippages. C’était lui, rien que lui, dont les rouages intérieurs s’étaient disloqués.
Et, tout d’un coup, le tintamarre tourbillonnant des mécanismes enchevêtrés et des aciers étincelants fit place, en son esprit, à une claire intuition des relations logiques qui commandaient les impitoyables cadences de ces barres en mouvement ; les leviers se mirent à danser en mesure avec une étrange cantilène que Hilliot, inconsciemment, avait modelée sur leur murmure, et il lui apparut qu’à travers tout ce complexe engrenage – pièce agrippant une autre pièce, tiges droites qui se levaient pour s’emparer de tiges courbes, leviers qui culbutaient en arrière, se contorsionnaient vers l’avant, – c’étaient sa propre raison d’être, ses propres conflits qui étaient en cause. Finalement, le sens même de son voyage lui devenait évident, et de cela, il devait rendre grâce au puissant, généreux navire. » (pp. 194-195)
Surgi de la brume d’un meurtre symbolique qui le grandit d’un coup (et sa révélation citée ci-dessus), balloté par la houle de lettres perdues, inventées, reconstituées puis abandonnées de sa bien-aimée qui n’est plus qu’un phare halluciné s’éteignant progressivement, dans la rouille des langues qui ne se comprennent pas et menacent de démantèlement la coque du vaisseau, Dana Hilliot finira-t-il par atteindre ce qu’il recherche ? Lui en restera-t-il, au moins, un souvenir assez cuisant pour que le désespoir ne soit pas complet ? « La pire souffrance est celle dont il ne reste rien », conclue-t-il, dans un élan final qui ne démêle rien. L’initiation, ici, ne fait que commencer. Chez les êtres concernés, elle ne s’arrête qu’à la mort, sauf si…
« Tel Melville, j’éplucherai ma cause comme un oignon, jusqu’au plus intime bulbe de la dégradation. »
Les autres livres de Lowry s’empilent déjà devant la fenêtre lumineuse de mes rêveries, me priant de ne point trop les faire attendre, je me retourne donc vers le coin sombre de mes lectures en ne concluant pas. Pas aujourd’hui.
/ Retour avant départ /
«La meilleure partie d’Ultramarine n’est que paraphrase, plagiat ou pastiche de votre œuvre» Malcolm Lowry à Nordahl Grieg, 1938. « Je n’ai aucun talent d’écrivain, j’ai débuté comme plagiaire. » (cité dans Malcolm Lowry, de Douglas Day)
Si l’on retrouve aussi ça et là de bons pillages de Conrad (comme ces pantoufles en tapisserie du commandant qui claquent sur le pont de Typhon) ou de Melville, rappelons-nous, pour consoler un écrivain qui se savait voleur, que lorsque le vrai loup de mer, espèce unique de l’île de Vancouver***, proche de là où Lowry s’isolera dans ses derniers jours, après avoir arraché sur la plage la carcasse de loutre à un congénère plus hardi qui l’aura, lui, tué dans les flots, déplace cette carcasse plus au cœur de l’île, il permet par ce rapt aux sédiments marins de se déposer en son centre et d’y faire pousser des fleurs.
Le voyage, décidément, ne se terminera jamais : après Melville ou Conrad, c’est avec Aiken et Grieg qu’il faudra, par la suite ou en attendant, repartir. Cela tombe bien, pourtant largement immobile, je ne tiens jamais en place.
___
*Malcolm Lowry, Ultramarine [nouvelle édition américaine 1962], traduit de l’anglais par Clarisse Francillon et Jean-Roger Carroy, Gallimard/Denoël [1965], L’imaginaire, 2004, 264 pages.
** Nécessité d’action dans un immense statisme : lecture soulevée par le Stalker dans sa note consacrée à ce roman.
***Voir « L’Île des loups », série animalière Netflix 2022 en trois épisodes.