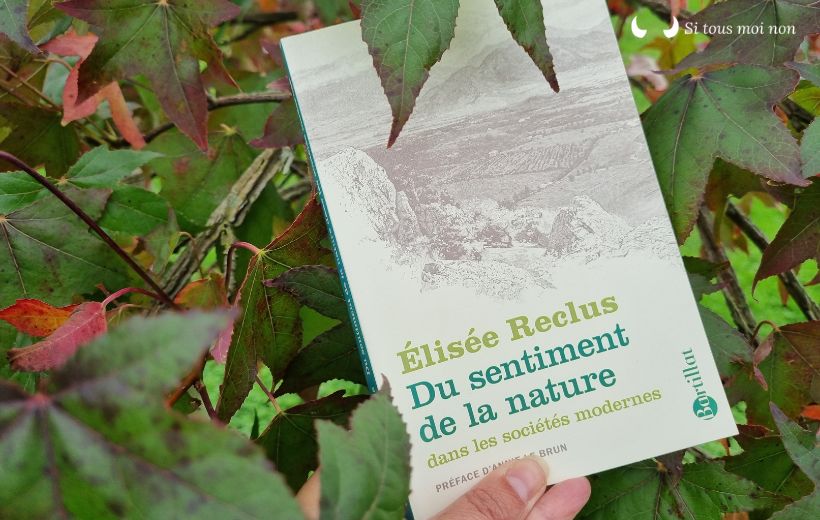« Pour pouvoir étudier une société primitive, il faut qu’elle soit déjà un peu pourrie. »
C’est avec cette sentence définitive en tête, prononcée par son ami et professeur Alfred Métraux, suicidé en 1963, que Pierre Clastres, 29 ans, chercheur en ethnologie, s’installe la même année auprès des « Aché », les derniers chasseurs-cueilleurs nomades des forêts denses du Paraguay, appelés également « Rats féroces », Guayaki. Vivant avec eux plus d’un an, il livrera de cette rencontre ces Chroniques, premier ouvrage capital, embryon des thèses de La Société contre l’État, l’essai de pensée sociale et politique qui suivra son retour en Europe, au retentissement désormais culte.
Persécutés par les « Beeru » (les Blancs), qui les tuent pour le sport et capturent leurs enfants pour les mettre en esclavage (pratiques reconnues jusqu’au milieu des années 1950), menacés de survivance panique par la constante réduction de leur territoire, décimés par les maladies occidentales, lorsque l’ethnologue les rejoint, les Indiens Guayaki ne sont déjà plus que l’ombre des guerriers libres d’une « société d’abondance », où seules trois heures de chasse et de cueillette suffisaient aux hommes pour nourrir amplement le clan, leur laissant le reste du temps libre pour l’amour, les fêtes et l’éducation des enfants. Patiemment, connaissant leur langue – bien que pas assez pour ne pas engendrer de cocasses malentendus – Clastres les soudoie avec des sucreries pour leur faire raconter leur passé, leurs habitudes, leurs rites et mythes, mais en respectant toute méfiance à se confier. « Quant à moi, je ne veux pas trop insister. Les Indiens ne sont pas en effet des machines à informer, et l’on se tromperait fort à les croire à chaque instant prêts à fournir réponse à toute question. Ils répondent s’ils en ont envie, s’ils se sentent de bonne humeur, s’ils en ont le temps. Ordinairement, la plupart d’entre eux préfèrent de beaucoup dormir à bavarder avec l’ethnologue et, en tout cas, les meilleurs renseignements sont souvent ceux que communiquent spontanément les Indiens », reconnaît-il.
Nous y apprenons, à sa suite, leur art d’accoucher, de se soigner et de mourir, leurs pratiques et tabous alimentaires et sexuels, leur passé douloureux au contact des colons, et, point central qui fascine immédiatement l’ardent chercheur déjà révolté par toute forme de coercition : leur gestion du pouvoir. Clastres, s’efforçant de tordre le cou aux pratiques ethnologiques en cours, teintées d’un ethnocentrisme irrémédiable ou presque (chaque groupe définit toujours les autres en fonction de lui-même), et même d’un « occidentalo-centrisme » galopant – si vous me permettez cette invention langagière pénible, ouvre grands yeux et oreilles pour capter et rendre avec le moins de préjugés possibles les dernières émanations d’un peuple dont la liberté l’enivre sans le duper. En délimiter le prix et reconnaître impossible la reviviscence d’un tel mode de vie au sein de nos sociétés avancées (mais pas nécessairement plus avancées) coordonne toujours, en ligne de fond, ses découvertes.
Cependant, naît entre ces pages l’idée qu’il développera plus profondément dans La Société contre l’État (sur lequel je reviendrai bientôt) et qui fera couler beaucoup d’encre dès la parution de Chronique en 1972 : si l’observation du modèle de plusieurs sociétés primitives (et pas seulement les Guayaki) indique que le pouvoir n’est si souhaité si envié par le groupe, qu’un chef n’y peut, par la force, imposer ses volontés sous peine d’être immédiatement démis par ses hommes mais qu’il doit au contraire faire don de ce qu’il possède – et par là, posséder moins que le reste du groupe qu’il guide, que ce n’est qu’en parlant qu’il peut rallier ses compagnons à ses vues en réveillant le souvenir des valeurs ancestrales auxquelles se soumettre (bien qu’il parle souvent dans le vide, assez comiquement nous le voyons, dans certaines scènes relatées), si l’exemple de ces sociétés indique que le pouvoir coercitif n’est nullement une fatalité, comment pouvons-nous nous berner, au XXe siècle, au point de promouvoir sa violence comme indiscutable au sein d’États conçus pour s’opposer, pratiquement, à la société plutôt que de la servir ?
De même, il apparaît très nettement que loin de simplement « survivre » en subissant une absence de croissance et de rendements qui leur permettrait de croître s’ils en avaient les moyens, les Indiens rencontrés, tout à fait conscients et capables de plus, choisissent de ne pas croître. En résumé, ce n’est pas qu’ils sont impuissants, c’est qu’ils ont la volonté du moins de puissance possible. Ainsi de ces chasseurs qui se savent excellents, mais ne se prétendent jamais meilleurs qu’un autre : la compétition leur apparaît absurde, il est invraisemblable de se mesurer à ses compagnons alors que chacun partagera avec les autres le fruit de ses chasses et ne gardera rien pour lui seul, de toutes façons. Tout est question de veine ou de déveine, que l’on a provoqué ou non par sa propre inconduite ou au contraire sa vaillance et qu’on peut rectifier en procédant à des purifications ou au respect stricts d’interdits – la plupart, alimentaires ou de résistance physique.
Surprenant à bien des égards, même lorsque l’on croit avoir déjà fait le tour des modes de vie tribaux, de leurs promesses et de leurs perditions, Chronique des Indiens Guayaki soulève ventre et cœur, provoque rire, admiration et commisération, impose son rythme décalé et l’humilité des maladresses reconnues par son auteur. Il est écrit avec la folle élégance d’un scientifique qui pense, vit et traverse son domaine avec fougue, sensibilité et créativité. S’il n’évite aucun sujet brûlant (l’inceste, le cannibalisme, l’homosexualité) il n’en abuse pas : c’est bien en assistant aux apparentes banalités du quotidien, en tendant l’oreille aux bruissements infimes d’êtres aux abois qui se savent disparaître dans un silence pesant, que l’on discerne furtivement, comme un jaguar derrière les lianes, les rapports si singuliers de ces nomades à l’autre, au groupe, à soi, à la forêt, à la joie… ainsi qu’à ce qui ne se voit pas, pour qui n’a pas posé ses pas dans les leurs.
Pierre Clastres, Chronique des Indiens Guayaki. Les Indiens du Paraguay. Une société nomade contre l’État, Plon, 1972 [Pocket, Terre Humaine poche, 2018], 314 pages. Livre acheté d’occasion.