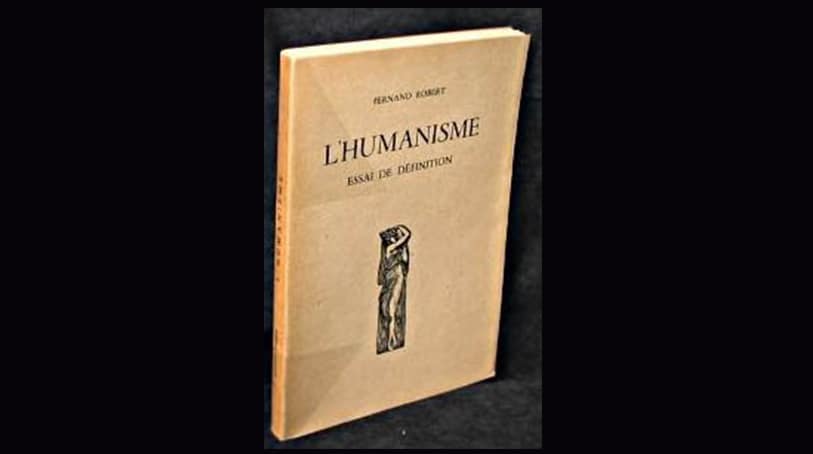« La façon dont Clastres parle des sociétés primitives amérindiennes constitue pour la gauche critique une des grandes incarnations conceptuelles du fait qu’un autre monde est possible ou que le capitalisme n’est pas sans dehors. »
Claire Pagès propose, dans Pierre Clastres, Les sociétés contre l’État, de partir sur les traces encore fraîches de ce penseur iconoclaste aux thèses aussi fascinantes que mises à mal depuis sa mort prématurée en 1977. Sa postérité quasi légendaire scintille dans de nombreux textes réfléchissant à cette question centrale, d’après La Boétie, « ce Rimbaud de la pensée » dont Clastres fut le fervent lecteur : comment se fait-il qu’un si grand nombre d’individus choisissent de servir un pouvoir coercitif, et ce, contre la plupart de leurs intérêts et alors qu’ils sont plus nombreux que ceux qui les gouvernent ? Chez Clastres, déterrer les racines de ce « double mauvais désir » de commander et de se soumettre demeure éminemment urgent.
La synthèse de Claire Pagès expose tout d’abord la véritable révolution copernicienne que les articles, puis livres de Pierre Clastres ont mis en mouvement dans les sciences humaines : il refuse la tradition alors établie de n’observer « le sauvage » que par le prisme des valeurs occidentales, le jugeant inférieur ou indigent.
« Au présentisme de la connaissance du divers répond son ethnocentrisme : la connaissance des autres n’a cessé selon Clastres de faire de la société occidentale le mètre étalon de toute société humaine et, ce faisant, de ramener l’autre (en l’occurrence le primitif) au même, de l’abolir comme autre. Ainsi l’ethnologie classique reproduit-elle la même erreur que la philosophie classique. »
Alors étudiant, puis jeune chercheur, il a étudié ces sociétés indiennes dites « primitives » de l’Amérique latine, en passant notamment huit mois auprès des Guayaki, ce qui donnera son premier livre. Il y a découvert une société organisée autour d’un chef respecté non pour son pouvoir, qu’il ne peut exercer par la force sous peine d’être rejeté par la communauté, mais par sa parole. Le chef est celui qui rappelle, qui exhorte, qui convainc, mais jamais n’impose. Dès lors, sa réflexion sur une sortie possible des schémas de domination consentie s’épanouit, en même temps que son style, direct et ardent, s’impose.
« Clastres témoigne qu’ont existé certaines formes de travail faisant alliance avec la nature, pour lesquelles la nature n’avait rien d’une ressource inerte « offerte gratis » ».
Il en découlera également une réfutation de la croissance comme idéal : pourquoi travailler à une société d’abondance, lorsque celle-ci produit d’insondables maux, alors qu’il suffirait de ne produire que la frugalité heureuse dont le groupe a besoin, une forme d’équilibre entre la nature et l’homme ?
Alors qu’il insiste clairement sur le fait que ces sociétés primitives ne sont pas, pour autant, des modèles réalistes pour l’Occident, ni même enviables, Clastres, à partir des années soixante-dix, fait toute la lumière sur la place de la violence au sein de ces sociétés. Si la violence étatique est refusée de prime abord, il n’en est pas de même d’une grande violence intime, éprouvée au quotidien. Le groupe n’opprime pas ses propres membres, mais les hostilités envers l’extérieur, et les pratiques rituelles effrayantes (scarifications, rites de passages, cannibalisme) sont légion. La question de la violence, de son refus et sous quelles conditions, devient dès lors prioritaire dans l’œuvre de Clastres, malheureusement inachevée : il trouve la mort sur une route des Cévennes, à 43 ans.
Celui dont les recherches ont nourri les penseurs anarchistes et écologistes, et guidé un Miguel Abensour, James C. Scott, David Graeber ou encore Philippe Descola dans leurs propres développements mérite-t-il d’être relu en 2025 ?
« La gauche libertaire a trouvé chez Clastres l’assurance que l’État n’a rien d’une nécessité. […] Il participe selon Miguel Abensour de « la tradition de la liberté » ou d’une pensée du politique qui définit la démocratie comme refus de la domination, comme disparition de la relation de domination/servitude. »
Claire Pagès, professeur en philosophie sociale et politique, discrète pédagogue et fidèle aux textes de Clastres, signe ici un ouvrage moins hagiographique qu’honnêtement mesuré. Elle rappelle qu’en ces périodes de larges troubles environnementaux et sociaux, pour ne pas parler de crises politiques ouvertes, reprendre le fil des travaux d’une écologie détachée de l’illusion du pouvoir étatique, ou du moins en discussion avec la nécessité ou non d’un pouvoir souverain pour enrayer la folie de ce qui peut l’être encore, redécouvrir l’héritage direct de celui qui a démontré le plus finement la contradiction profonde entre écologie et pouvoir, ne saurait nuire.
Alors que je dévore, parallèlement à cet essai, les livres de Clastres, je ne saurais pour ma part mieux dire.
Si ce n’est que son essai, en 150 pages avec notes, chronologie et bibliographie étayée, permet un abord serein et profitable à l’œuvre encore aujourd’hui provocatrice et stimulante d’un chercheur singulier qui ne se prit jamais pour le centre du monde.
Claire Pagès, Pierre Clastres, Les sociétés contre l’État, Éditions Amsterdam, 2024, 156 pages. Ouvrage reçu dans le cadre d’une opération Masse critique sur Babelio.