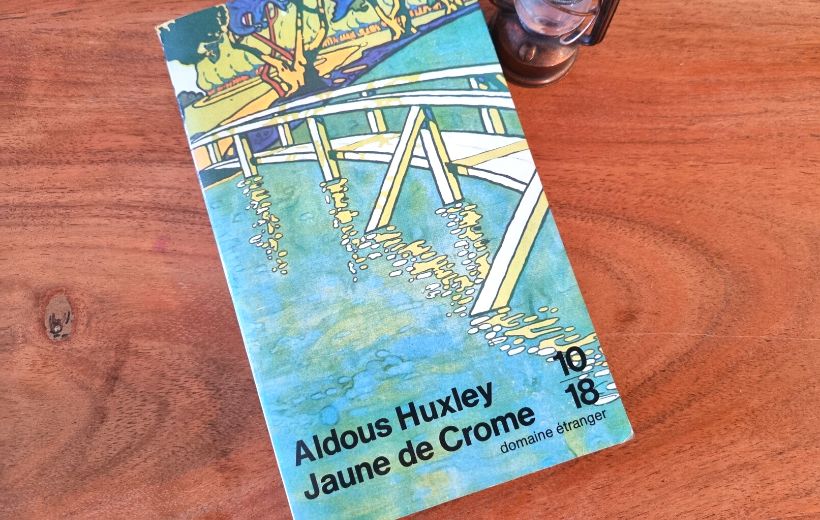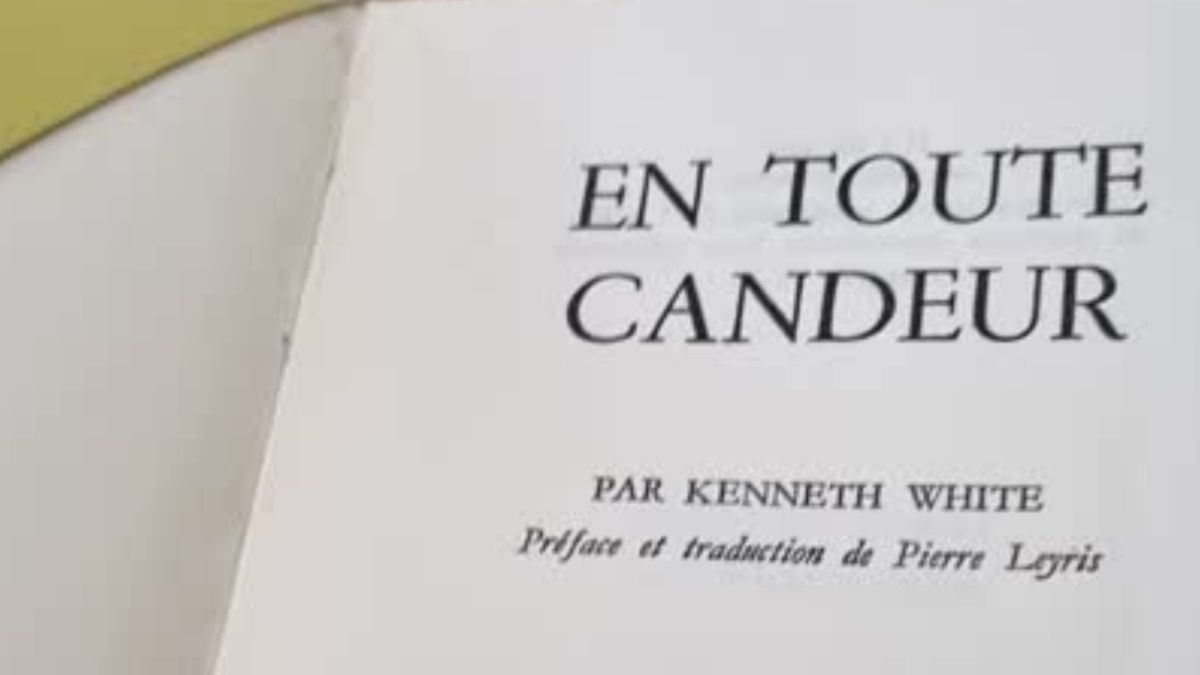Don’t let me falter, don’t let me hide
Don’t let someone else decide
Just who or what I will become
I Am Kloot, Avenue of Hope
« Je vais peut-être bientôt avoir un emploi dans une petite ville de province, ce qui serait pour moi à présent la meilleure des choses. Une petite ville, c’est ravissant. On y a sa bonne vieille chambre pour un prix étonnamment bas. (…) Le soir, on rentre à la maison dans une chambre bien chauffée et on regarde les tableaux sur le mur, dont l’un pourrait peut-être représenter la belle impératrice Eugénie et un autre, une révolution. La fille de la maison entrerait peut-être pour m’apporter des fleurs, pourquoi pas ? Tout cela n’est-il pas possible dans une petite ville où les gens s’aiment bien les uns les autres ? Un jour, cependant, qu’il ferait chaud et clair, au moment de la pause de midi, la même fille frapperait timidement à la porte, une porte entre parenthèses dans le style rococo, qu’elle ouvrirait, et elle entrerait ainsi dans ma chambre et, en penchant la tête de côté d’un mouvement infiniment gracieux, elle me dirait : « Vous êtes toujours tellement silencieux, Simon. Toujours si modeste, sans jamais rien réclamer. Jamais vous ne dites : il me manque ceci ou cela. Vous laissez aller. J’ai peur que vous ne soyez pas content… » Je me mettrais à rire et je la rassurerais. Et alors, prise soudain de sentiments étranges, il pourrait lui arriver de dire : « Comme ces fleurs, là sur la table sont silencieuses et belles. On dirait qu’elles ont des yeux et j’ai l’impression qu’elles sourient. » Je serais surpris d’entendre ce genre de choses dans la bouche d’une provinciale. Et puis tout à coup je trouverais tout naturel de me diriger vers elle qui reste là interdite devant moi, de mettre mon bras autour de sa taille et de l’embrasser. Elle se laisserait faire mais pas d’une façon qui vous ferait avoir de mauvaises pensées. Elle baisserait les yeux et j’entendrais les battements de son cœur, la vague qui monterait dans ses beaux seins ronds. (…) Je l’embrasserais encore une fois sur la bouche, avec cette courbe étrange qu’elle a, et je la flatterais d’une façon qui l’obligerais à croire mes flatteries, et ce ne seraient donc plus simplement des flatteries, et je lui dirais que je la considère comme ma femme, sur quoi, en penchant de nouveau la tête de côté comme elle fait admirablement, elle dirait oui. Car que pourrait-elle bien me répondre si je lui fermais la bouche, comme on ferme la bouche des enfants, et que je la couvre de baisers, ma merveille, qui ne pourra pas tout à fait dissimuler à ce moment-là un sourire d’orgueil et de victoire ? C’est qu’en effet la victorieuse, ce serait elle, et moi le vaincu, on le verrait bien vite car je deviendrais son mari et du même coup je lui ferais le sacrifice, le cadeau de toute ma vie, de ma liberté et de toutes mes envies de voir le monde. Désormais je ne ferais plus que la regarder et la trouver toujours plus belle. Jusqu’à notre mariage je serais toujours à ses trousses pour surprendre ses charmes qu’elle ne manquerait pas de montrer. Je l’observerais pendant qu’elle serait à genoux sur le plancher de la chambre devant le poêle pour allumer le feu du soir. Je rirais beaucoup comme un idiot, simplement pour ne pas avoir toujours besoin de dire des mots tendres trop compliqués, et peut-être qu’assez souvent je la rudoierais pour surprendre les expressions de son visage quand elle souffre. Après l’avoir traitée ainsi je n’hésiterais pas, secrètement, sans qu’elle me voie, à m’agenouiller devant son lit, à l’adorer absente, avec ferveur. J’irais même jusqu’à prendre son soulier, avec le cirage encore frais, et à le presser contre ma bouche ; l’objet qui aurait enserré ses petits pieds blancs suffirait absolument à nourrir mon adoration, il n’en faut pas tellement pour pouvoir prier. Assez souvent aussi j’escaladerais les rochers de la montagne toute proche en m’agrippant aux racines des arbustes, le cœur léger, des abîmes sous moi, et une fois là-haut sur un éboulis je m’étendrais dans l’herbe jaunie et je commencerais à me demander où je suis et si une vie pareille, étroitement unie à celle d’une femme que j’aime, certes, mais qui réclame absolument tout de moi, pourrait me contenter. Je hocherais simplement la tête en réponse à ces questions, je me sentirais merveilleusement en forme et je laisserais descendre mes songes dans la vallée où s’étendrait la petite ville. Peut-être pleurerais-je une demi-heure, pourquoi pas, pour dissiper ma mélancolie, cela me calmerait et je serais à nouveau heureux d’être là attendant que le soleil se couche et puis de redescendre et de tendre la main à ma fiancée. Tout serait décidé et refermé à double tour derrière moi, mais justement cette fermeture solide, contraignante, me mettrait la joie au cœur. Je fêterais aussitôt mon mariage et je donnerais ainsi à ma vie une nouvelle vie. L’ancienne serait comme un beau soleil qui se couche et sur lequel je ne me retournerais même pas pour un dernier regard parce que je jugerais cela dangereux et faible. Le temps passerait et à présent l’image de notre amour ne serait plus que nous nous penchions ensemble sur des fleurs, mais bien sur des enfants qui nous raviraient par leurs sourires et leurs questions. L’amour de nos enfants et les mille soins qu’ils réclameraient rendraient notre propre amour plus paisible mais d’autant plus grand, simplement plus silencieux. Je ne songerais jamais à me demander si ma femme me plaît encore, et me dire que je mène une petite vie mesquine ne me viendrait jamais à l’esprit. J’aurais appris tout ce que la vie peut apprendre et je renoncerais volontiers au genre de pensées qui me représenteraient toutes sortes d’aventures élégantes que j’aurais manquées. « Que signifie encore le mot manquer », me demanderais-je calmement et avec assurance. Je serais devenu quelqu’un de solide, tout simplement, et je le resterais jusqu’à la mort de ma femme, dont ce serait peut-être le destin de mourir avant moi. Mais je ne veux pas penser plus loin ; car enfin le reste est enfoui dans l’obscurité d’un bel avenir. Que dites-vous de tout cela ? Je rêve toujours tellement en ce moment, mais vous devez au moins reconnaître que je rêve avec une certaine honnêteté et avec le désir de devenir meilleur que je ne suis maintenant. »
Robert Walser, Les enfants Tanner, traduit par Jean Launay, Gallimard, Du monde entier, 1985, pages 111-114.
Crédit photo : screenshot de Sunshine, de Danny Boyle.