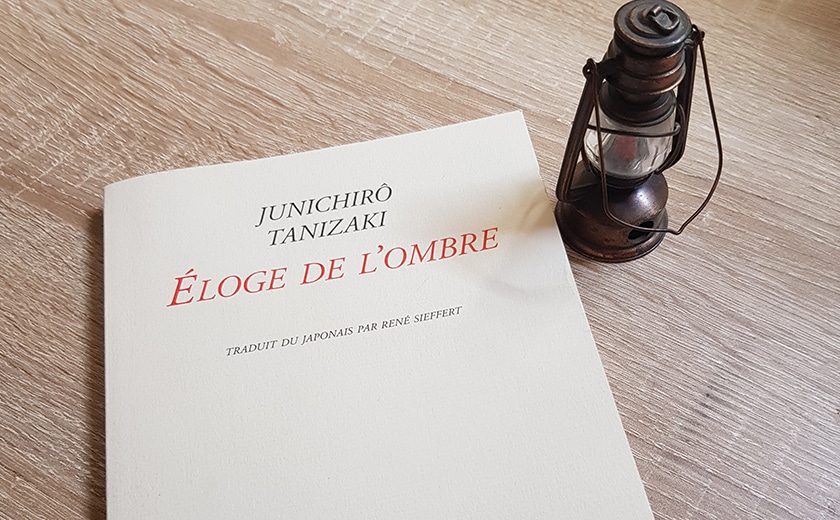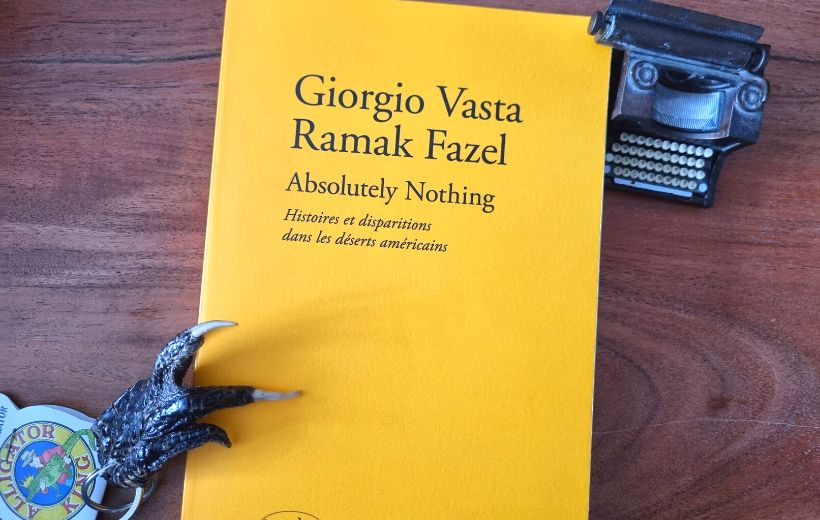God may forgive me, but that’s not enough
‘Cause I gotta live with myself, ’till I’m dust
Just walk on by, if we pass on the street
Sometimes in battle, it’s best to retreat
Dan Auerbach, Heartbroken In Disrepair
« Ce que je veux dire, c’est ceci : voyagez, étudiez ou prenez un emploi. C’est vous qui savez le mieux ce qui vous convient. Mais, quoi que vous fassiez, n’oubliez jamais de vous dire que vous n’êtes pas prisonnière de la voie que vous avez choisie. Vous êtes pleinement en droit de changer d’itinéraire si vous estimez que vous êtes en train de vous égarer. La vie exigera de vous des prestations qui vous paraîtront répugnantes. Il faut donc que vous sachiez que le plus important n’est pas la prestation mais ce qui vous permettra de devenir quelqu’un de bien et de droit. Ils seront nombreux à vous dire que c’est là un conseil asocial, mais vous n’aurez qu’à leur répondre : quand les formes de la société se font par trop dures et hostiles à la vie, il est plus important d’être asocial qu’inhumain. »
Stig Dagerman, L’avenir radieux in Dictature du chagrin et autres écrits amers
Le postulat de Dan O’Brien est simple, au départ de son récit Buffalo for the Broken-Heart* : raconter son désir déraisonnable de rendre à une parcelle de terre du Dakota son aspect ancestral, loin de toute manipulation chimique et technologique de l’homme. Revenir à une terre saine. En 1997, échaudé par sa chute du royaume conjugal, abandonnant l’idée de se reproduire pour en laisser le loisir à d’autres, il rachète le ranch du Broken-Heart, au milieu des Grandes Plaines, et assouvit ainsi son besoin de solitude et d’espace. Il est fauconnier, connaît donc bien la faune, et auteur de déjà quelques romans (majoritairement écrits autour des Indiens Lakota), il sait aussi manier la plume. Entre les péripéties grotesques d’un matériel défaillant, et les bourrus avinés de son coin, il cite Catlin ou Tchékov, puis retourne fumer son clope sous le porche.
Mais les terres, revêches, s’avèrent bientôt plus dures que prévu à manier, et l’homme déprime dans sa pampa, effrayé des dettes qui s’annoncent.
Le récit, alors, véritablement, commence.
Un soir, arpentant son domaine, il manque de renverser un bison. Il s’émerveille et s’étonne de la placide majesté de la bête, parfaitement intégrée au paysage.
Un bref historique de l’histoire des bisons des Grands Plaines, depuis le massacre de Buffalo Bill, jusqu’aux tentatives infructueuses d’implantation de vaches espagnoles nous donne un aperçu du malaise pressenti par l’auteur devant ces étendues désolées : l’agriculteur actuel laboure un vaste cimetière, une scène de crime parfaitement nettoyée de ses animaux sacrés, exterminés jusqu’au dernier pour nourrir les travailleurs du chemin de fer, les carcasses profanées, au profit de raffineries de la côte Est. Et le bison, depuis cent ans, rayé tout simplement d’une carte trop grande et dépeuplée.
Par un concours de circonstances, admirablement dépeint en une scène épique à l’air pur et piquant, un ami éleveur lui demande de l’aide pour conduire ses bisons d’un pâturage à l’autre, puis en désigne treize, trop petits, trop faibles, qu’il va falloir tuer. C’est une révélation. Sur un coup de tête, mal préparé à la série d’embûches qu’il va rencontrer dans sa démarche démesurée, O’Brien fonce tête baissée dans l’aventure : si les petits bisons passent l’hiver, il développera son troupeau.
« J’avais soif de renseignements et ingurgitais tous ces documents. Jusqu’à ce que, persuadé que les bisons étaient le doux remède qui redonnerait santé aux Grandes Plaines, je contracte le syndrome du spleen du bison. »
Et les petits passent l’hiver. Sauf un. Mille vaches seraient mortes, soumises à une telle rudesse de climat, toujours imprévisible et menaçant. Mais douze bisonneaux, sous les flocons, marchant contre le vent, creusant pour trouver et garder l’eau et broutant sous la glace, survivent sous le regard de leur protecteur angoissé, et scellent le destin d’un homme d’ores et déjà conquis.
« J’étais inquiet mais une statistique est venue m’encourager. Au cours de l’hiver 1997-1998, soixante mille vaches et moutons ont péri dans les Grandes Plaines, morts de faim, de froid, tombés à travers la glace et noyés, trébuchant des falaises lors des voiles blancs. Bien sûr, il y a moins de bisons sur les plaines ; cependant, on n’a répertorié qu’une seule mort de bison. Il a été poussé d’un pont gelé par un trente-cinq tonnes. »
Lorsque que le petit dernier de ses treize bisons meurt, il abandonne le cadavre aux coyotes, et contemple alors un spectacle inconnu sur ces terres depuis un siècle. Le sentiment d’un retour total à une nature reconnaissante.
L’histoire et sa narration sont assez simples, presque banales. Mais sur une trame modeste, l’homme tisse des portraits d’hommes tourmentés entre une nature idéalisée et des conditions de vie brutales. L’alcool, le suicide bien sûr, la solidarité, la primitivité, auraient pu s’incarner en de féroces clichés, mais toujours l’espace vide et hostile fait force, confronte ses misérables habitants, et le lecteur avec, à des limites patiemment repoussées, à une vaillance et une détermination désespérées, et inattendues.
« La personnalité mythique américaine est un mélange d’équité, d’autonomie, d’endurance et d’honnêteté. Ces vertus se logent généralement au sein d’un grand homme brun et dégourdi, à la fois attaché à sa famille et séduisant aux yeux des inconnues, insouciant et stable, réaliste et fantasque. Dans la tradition américaine, cet homme vit dans les Grandes Plaines. Il est originaire du Texas, de Dodge City, de Cheyenne, du Dakota, ou d’un quelconque coin du Montana. En fait, les racines de cet Américain s’enfoncent dans le mythe de la Frontière, et ce depuis Tocqueville, en passant par Andrew Jackson, Wyatt Earp, les cavaliers du Pony Express, les pionniers, les cow-boys, et jusqu’aux caricatures contemporaines incarnées par des acteurs comme Tom Mix, Gary Cooper et John Wayne. La Frontière, peuplée de chevaux, est un lieu de grands espaces propices à l’errance, aux énormes couchers de soleil, aux délimitations précises entre le Bien et le Mal. C’est aussi un endroit qui n’existe pas et n’a jamais existé. La vérité, c’est qu’il n’y a jamais vraiment eu d’équité dans ce coin. »
Et les bisons s’épanouissent, élevés dans la tradition ancestrale, c’est-à-dire laissés libres et sans trop intervenir, et le pronostic s’avère vital. On décèle chez l’auteur une confiance retrouvée, une dimension de gagnée. Son écriture prend de l’ampleur, l’émotion et la quiétude sont diffusées dans des descriptions et analyses fines et pertinentes.
Lorsque le premier bison est tué, débité, et savouré au coin du feu, loin de s’horrifier stupidement d’un meurtre sanglant, on goûte avec l’auteur à un mets de respect et de liberté. Le Broken Heart s’est apaisé, et la région, ayant retrouvé ses racines, recommence à peine à prospérer. Dan O’Brien, lui, a réussi un témoignage contagieux, un appel au souffle réparateur.
« On s’est séparés tout sourire et les mots de Stan ne m’ont pas quitté. Il avait dit : “ C’est bon de les avoir avec nous. “ Comme s’il avait vu les empreintes sur sa propre peau. »
* Dan O’Brien – Les bisons de Broken Heart, Editions Au Diable Vauvert, 2007, Folio 2009.