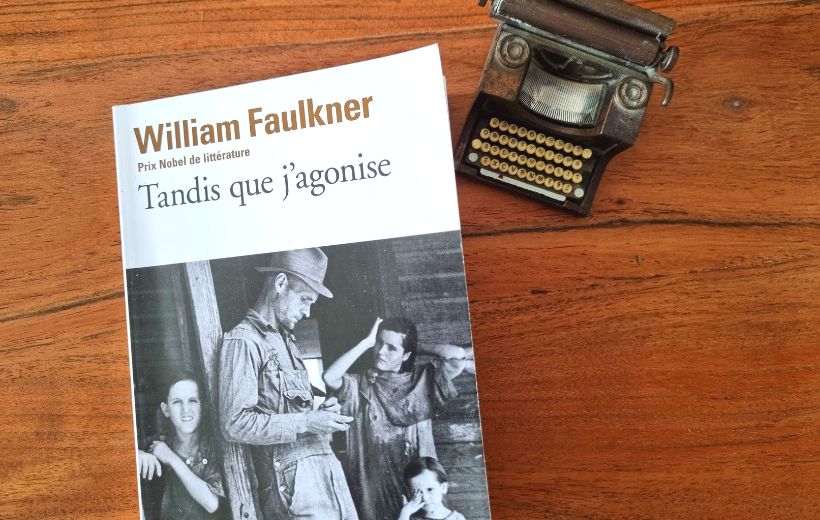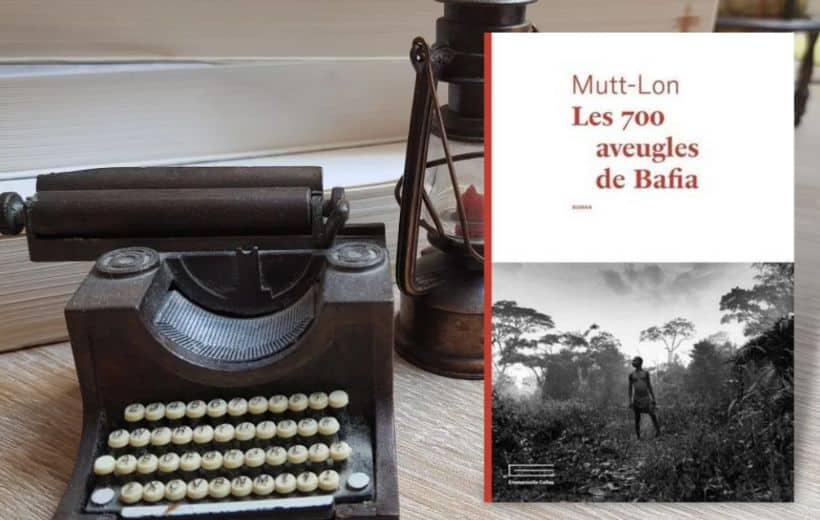« Les pieds ont tassé le sentier et juillet l’a durci comme de la brique. »
Addie Bundren se meurt. Dès les premières pages (rendant plus énigmatique encore le titre), elle trépasse et doit être enterrée. Dans sa ferme isolée, au milieu d’une route, ses cinq enfants et son mari Anse s’activent : ils doivent rejoindre Jefferson, « la ville », où la mettre en terre à côté de ses parents. En plein mois de juillet, alors que le travail bat son plein dans un Sud où l’orage menace de sa colère homérique, cela ne pouvait tomber plus mal, mais ils ont promis.
« Le soleil, depuis une heure au-dessus de l’horizon, est posé comme un œuf sanglant sur une crête de nuages d’orage. La lumière a pris une teinte cuivrée : menaçante à l’œil, sulfureuse au nez, pleine d’une odeur d’éclairs. »
Cash, l’aîné artisan boîteux, se hâte de terminer lui-même le cercueil, pressé par Jewel, le fils indomptable monté sur un cheval pas plus docile, Darl l’étrange « … les yeux perdus plus loin que son manger, plus loin que la lampe, pleins de la campagne extraite de son crâne, les trous remplis de l’immensité de la terre », Dewey Bell, adolescente à secrets et Vardaman, le petit dernier éberlué de chagrin.
Chacun à son tour, ainsi qu’une poignée d’autres personnages de l’entourage, prend vie en un monologue intérieur incommunicable aux autres, emmuré dans ses empêchements de diverses natures, lors d’un périple des plus décourageants. Souvent, leur langue bute comme la bêche dans un terrain aride, elle se rend, ne termine pas ce qu’elle commence « comme un petit garçon, dans le noir, pour se donner du courage, qui s’effraye tout à coup de son propre bruit. »
« Nos terres, c’est comme nos rivières : opaques, lentes, violentes, modelant, créant la vie des hommes à leur image, implacable et méditative. »
Pour « ceux qui se sont rien », ou presque, franchir les kilomètres qui les séparent de leur destination avec un cercueil dans une charrette tirée par deux mules tout en luttant contre les multiples obstacles de la nature s’apparente à une longue, très longue expiation de leurs singulières existences dont ils prennent peu à peu conscience. Et le lecteur seul saura, collectant les multiples signes et clé donnés tant par les uns, tant par les autres, afin de reconstituer l’ensemble incertain et fragile, que la mort de leur épouse et mère n’est pas pour chacun l’occasion de la même traversée.
L’épreuve de ce trajet, qui semble n’avoir aucun sens ni même espoir de réussite, n’épargnera personne, et surtout pas le lecteur : Faulkner entendait avec ce livre choral réussir à livrer un tour de force : il n’a pas échoué. Plusieurs scènes d’anthologies préfigurent les grandes pages à venir de nombre d’autres écrivains impressionnés, Cormac McCarthy s’en étant sans doute le plus remarquablement inspiré (je pense à la scène du cheval sur le bac dans L’Obscurité du dehors, aux nombreux échos avec celle de la traversée de la rivière en crue par la charrette portant le cercueil).
« Et puis il est mort. Il ne savait pas qu’il était mort. Couchée près de lui, dans l’obscurité, j’entendais la sombre campagne parler de l’amour de Dieu, de Sa beauté, de Son péché. J’entendais l’obscurité sans voix où les mots sont les actions et où les autres mots, ceux qui ne sont pas des actions, ceux qui ne sont que les vides dans ce qui manque aux gens, descendent comme les cris des oies, ces cris qui, dans les terribles nuits d’autrefois, descendent des ténèbres sauvages à la recherche des actions, comme des orphelins à qui on montre deux visages dans une foule en leur disant : Voici ton père, voici ta mère. »
Le monologue central (le seul), de la mère, éclairera à peine les obscures contrées dans lesquelles le lecteur s’avance à tâtons, lâché dès le début par elle, la seule, Addie, qui aurait pu le guider un peu mieux au cœur de ces êtres livrés à eux-mêmes, comme incapables de suivre et qu’elle avait si amèrement cernés : ils sont tous déjà morts, leur vie est un malentendu enclavé dans une terre qu’ils supportent pour la récompense du Ciel. Leur entêtement formidable n’a rien à voir avec une promesse à tenir à l’aimée : ici, personne ou presque ne s’aime. Il ne s’agit pas de cela. Les seuls à cœur ouvert, Darl le fou et Vardaman le petit enfant, le paieront tôt ou tard. L’un en se faisant enfermer, l’autre en apprenant bien trop tôt à tout refouler. Les autres sont absents à l’appel, ils incarnent sans formuler, ou bien leur verbe est une longue peine. Fonctionnels, tannés : embourbés, ils ont leur destin bien appris et ne lutteront jamais.
« C’est un fait à remarquer qu’un homme paresseux, un homme qui n’aime pas le mouvement, s’entête toujours à aller de l’avant une fois qu’il est parti. C’est exactement comme quand il refusait de bouger. Comme si ça ne serait pas tant le mouvement qu’il déteste que le fait de partir ou de s’arrêter. On dirait presque qu’il est fier de tout ce qui peut survenir pour donner à son mouvement ou à son immobilité l’air d’être difficile. »
Ce qui, lorsqu’on connaît un peu la campagne, ne peut pas être plus vrai, partant plus intolérable. Dans une préface assez peu développée et étrangement morne, Valéry Larbaud affirme que la qualité et la vérité humaines des personnages dépasse leur exotisme. Je suppose qu’il ne connaissait pas la Beauce. Aujourd’hui encore, rien n’est moins exotique que la famille Bundren pour qui vit dans l’enclave des sentiers, cahotant sur leurs pierres, soumis aux éléments, écrasé par juillet. Pour les autres, ils pourront saisir et endosser le temps d’un livre, grâce à l’impeccable ubiquité du maître du Sud et sa plume sourde aux demandes de pitié pour ses tristes condamnés, l’absurde difficulté d’entreprendre quoi que ce soit qui sorte de l’ornière lorsqu’on est assigné aux tâches de la terre.
« Ce pays est dur aux hommes, bien dur. Huit miles de leur sueur arrachés à la terre du Seigneur, là où le Seigneur lui-même leur avait dit de la faire couler. Dans ce monde de péché, les hommes honnêtes et travailleurs ne peuvent pas profiter. C’est ceux qui possèdent les magasins dans les villes qui, sans sueur, vivent de ceux qui suent. C’est pas le travailleur, le paysan. Des fois je me demande pourquoi nous continuons. C’est à cause de la récompense qui nous attend là-haut, là où ils ne peuvent pas emmener leurs autos ni le reste. Tout le monde sera égal, là-haut, et le Seigneur prendra à ceux qui ont, pour donner à ceux qui n’ont pas. »
En postface, Michel Gresset qui revient surtout sur la réception du texte, alimente l’idée lue ça et là d’un voyage funéraire empruntant à la farce. Je ne suis ici encore pas du tout en accord : je ne trouve rien de plus tragique, de plus bouleversant, de plus « réel » que l’acharnement des personnages à mener à bien leur trajet, ni rien de moins drôle que les ironies mordantes qui les contraignent et les brisent : c’est là le lot de celui qui subit mais veut pour une fois, s’il ne devait y en avoir qu’une, et sans plus vraiment retrouver le début du pourquoi, rester debout. Une farce ? sans doute pour tous ceux qui ont déjà rejoint le confort prévisible d’une existence réglée et n’ont point assez de cœur pour comprendre de quoi il en retourne…
Car Faulkner, s’il pratique l’esprit et l’humour en un savant dosage, aime ses personnages profondément et sans aucun mépris : cela m’avait considérablement frappée dans ses Croquis de la Nouvelle-Orléans. Et cet amour à la dure qui n’évite rien mais tient toujours haute une part digne dans chaque malheur d’un risible quotidien, est le talent instinctif brut impossible à manufacturer à grande échelle, qui maintient les grandes plumes rares mais invaincues. Sans cet amour, alors que la plupart de ses personnages en semblent bien dépourvus (mais méfiance, il ne s’exprime pas chez le rustre de la même manière que chez l’empressé maniéré – ainsi de Darl, par exemple, qui préfèrera risquer détruire une grange par le feu que de laisser sa mère pourrir plus longtemps au soleil), sans cet amour : ils seraient perdus.
C’est parce que ces écrivains nous aiment quand nous ne sommes rien, que nous tenons debout, me dis-je parfois, dans l’œil du cyclone. C’est un pari comme un autre pour ne jamais désespérer…
William Faulkner, Tandis que j’agonise [1934 pour la traduction française de Maurice Edgar Coindreau], Gallimard, Folio, 2022, 254 pages.